La démocratie à l’ère du tout numérique
- Salim Mokaddem
- 24 oct. 2024
- 11 min de lecture
Un monde dans lequel le numérique réduit l’ensemble des problèmes politiques à des calculs nécessaires, binaires et non dialectiques, sans délibérations et sans décisions produites par des jugements de réflexion.

Notre époque est marquée par une épistémé de la rupture, de la discontinuité, du refus de l’universel, et par un certain retour aux identités et aux affirmations identitaires. Les individus sont enfermés dans des psychaï et des modes de vie autocentrés, se manifestant, entre autres, par des slogans et des devises narcissiques fièrement affichées sur leurs vêtements (1) («parce que je le vaux bien» ; «do it yourself» ; «be yourself» ; etc.). L’époque est à la dépression et aux replis sur soi, lesquels ne se fondent pas toujours sur un soi véritable, car celui-ci est souvent grevé par ces pertes de consistance sémantique autant qu’éthique.
Ce narcissisme n’est pas existentiellement choisi selon des pratiques de vérité et des techniques de vie (Hadot (2) ou Foucault (3)) relevant de l’autonomie de sujets libres et réfléchis. Au contraire, ces structures psychiques sont déterminées par des artefacts liés à des « machinages » ou à des process sociétaux relevant de technostructures et de biopolitiques spécifiques.
Ces sujets sont, de façon plus ou moins consciente, autocentrés et vidés de toute poésie parce qu’il y a une mutation ou un changement dans la technostructure des modes de productions et des forces productives les portant et les instituant comme tels : le numérique installe systématiquement une nouvelle relation entre sujet et objet, d’une part, et, entre travail, temporalité, machine et productivité, d’autre part.
Dans les sociétés post-industrielles, le consumérisme devient une finalité du capitalisme productiviste et un mode de fonctionnement général, holiste, de l’économie financiarisée dans un monde régi par des calculateurs d’algorithmes. Le sujet est alors considéré comme une machine désirante (Deleuze et Guattari (4)) branchée sur la consommation de masse, et surtout il est (le) produit par une société de fictions et de propagande (Bernays (5)) visant à automatiser sa vie intime et sa subjectivité.
De la politique au calcul
Le numérique fait disparaître l’idée de liberté en réduisant l’ensemble des problèmes politiques à des calculs nécessaires, binaires et non dialectiques, sans délibérations et sans décisions produites par des jugements de réflexion puisque les individus deviennent alors des opérateurs et des objets déterminés par des matrices algorithmiques réductibles à des matrices ou à des arborescences analytiques.
On peut alors tenter de comprendre où va notre démocratie à ce rythme qui épuise les sujets de l’intérieur par des sollicitations permanentes du monde présentiste des médias et du contrôle psychosocial exercé par nos métadonnées et les applications en action dans notre monde de surveillance électronique.
Quatre questions légitimes peuvent alors se poser :
Peut-on déléguer l’esprit critique et la liberté en matière de décision démocratique ?
Sur quelle vision de l’homme et de la société repose une conception qui définit l’homme par des calculs et des enchaînement de raisons nécessaires ?
L’histoire, le droit, la loi sont-ils solubles dans une rationalité calculante ou dans une mathesis universalis ? La société civile et l’Etat peuvent-ils être des identités remarquables de nature mathématique ou faut-il introduire des éléments historiques non nécessaires (car relevant de l’événementialité propre à la causalité libre) pour comprendre les dérives identitaristes et différencialistes contemporaines ?
Assiste-t-on à une redéfinition de l’humanité (post-humanisme, homme augmenté, processus de machine désirante et de cyborg, etc.) qui oblige à penser le présent comme une postmodernité délaissant le récit historique et la continuité progressiste de la démocratie occidentale, comme ce fut le cas, par exemple – mais pas seulement dans cette philosophie systématique de l’histoire – dans une perspective hégéliano-marxiste ?
Une ère hyperlibérale voire post-libérale
L’enjeu est de taille : nos sociétés sont-elles définitivement ancrées dans une ère d’hyper-libéralisme voire de post-libéralisme qui peut se passer de délibérations politiques et de décisions démocratiques ? Cette disruption est-elle sans conséquences pour nos libertés et pour l’agencement républicain de nos institutions ? La notion d’institution a-t-elle même encore un avenir ? Et, partant, celles de sujet et de collectif, quand l’algorithme et le story-telling gèrent désormais les machines désirantes passives que sont les sujets des Cités post-modernes ?
Le risque est que la disparition du politique et de la politique comme philosophie critique du jugement emmène avec elle un impérialisme du code formel au détriment du langage et de la pensée, donc du désir du sens et de l’humanisme.
Quelle est donc la finalité du vivre ensemble et de l’être ensemble aujourd’hui ? Cette question méritera d’être abordée afin d’éviter de penser que la technique et les sciences donnent la réponse adéquate et irréfutable, sinon définitive, aux questions fondamentales que l’être humain se pose et doit constamment se poser pour devenir et rester humain autant qu’il est possible, et qu’il le doit au regard de l’Idée régulatrice qui préside son être au monde, avec et pour les autres, autant que pour son amélioration éthopoïétique (6).
Le problème du sens du vivre-ensemble
La négation de l’histoire et du sens temporel constituent les paramètres de l’époque qui insiste paradoxalement sur l’innéisme, le naturalisme, la biodiversité, la biopolitique, l’écologie, la mode, le branché, le in, le hip, etc., contre l’analyse des déterminations complexes de l’histoire comme mouvement dialectique de la construction de l’identité comme produit logique et concept réflexif.
Le numérique se caractérise actuellement par la force des algorithmes qui réduisent le qualitatif au quantitatif et permettent ainsi une lecture algébrique, et non plus symbolique, du réel réduit alors à des entités formelles abstraites, simplifiées, permettant des calculs et des mesures pour une rationalité d’entendement, procédant par évaluations sommatives et par ratios algébriques des coûts et des pertes du point de vue d’une calculabilité comptable arraisonnant le monde comme économie de type chrématistique.
Cependant, l’histoire des sociétés de droit est celle de la libération des humains de la nécessité naturelle. Elle est marquée par l’émancipation historique de la physis par la praxis : le progrès des forces productives (âge de pierre, de fer, bronze, etc.) ne peut être inséparable des progrès de la raison technique, théorique, pratique et d’une anthropologie de la culture. Or, les TIC, les NBIC et les économies numériques maintiennent l’esprit dans un présent de calcul sans temporalité autre que le présent, décontextualisé. Le monde présentiste du numérique est sans repérages chronologiques et sans singularités culturelles. Il est justement dématérialisé et donc essentialisé de façon abstraite et indifférenciée.
Le numérique et ses dérivés sociétaux (smartphone, applications, réseaux sociaux, notifications, etc.) rivent l’individu à l’image virtuelle d’une chaîne de chiffres (1 et/ou 0) et à un cordon ombilical narcissisant – celui de la notification continue des applications – qui ont un rôle addictif de protection affective contre l’angoisse de vivre et une fonction de sécurisation constante par un bien-être performatif (produisant dopamine et sérotonine) qui ancre le psychisme, et ce depuis la petite enfance, dans une sorte d’hallucination continue. Cet attachement produit de la dépression quand l’individu quitte ce monde virtuel. D’où les désocialisations et les risques d’isolement que produisent alors les jeux, les applications, les alertes et les veilles permanents du monde de la numéricie.
Il est difficile de décentrer les psychismes quand ils sont dépendants des flux numériques. Et encore plus de demander de l’attention et du sens critique vis-à-vis des événements extérieurs à des esprits toujours occupés d’eux-mêmes. L’époque vit cette disruption dans l’hyperactivisme des enfants, la révolte permanente et pulsionnelle des adolescents, l’individualisme autocentré des adultes et la dépression des personnes âgées en fin de vie.
Ce malaise dans la société est un malaise civilisationnel et politique. L’enfermement dans et par soi, la citadelle de l’âme prisonnière en elle-même, inhibe et empêche les liens sociaux et politiques de se constituer en collectif porté par des sujets autonomes et responsables. Une démocratie ne peut exister dans une société atomisée d’individus séparés les uns des autres et vivant dans un monde monadique, au sens de Leibniz, mais sans l’harmonie pré-établie et le vinculum substantialis qu’il mettait au principe de l’universel, réglant les monades entre elles dans un lien de co-appartenance et d’entre-expression.
La question de la formation du jugement critique est essentielle pour une démocratie authentique : c’est le sens de l’Ecole dans la République, et ce fut, entre autres, le combat de Condorcet, reprenant le programme des Lumières et de l’Encyclopédie afin d’éclairer le genre humain par les savoirs. Il y a de la naïveté dans le mouvement des Lumières qui articulaient de façon platonicienne eschatologie et acquisition des savoirs dans une vision de la conversion de l’âme confrontée à l’Idée du Bien. Nous savons que les Lumières avaient en elles certaines ombres terribles, dangereuses et assassines ; l’histoire des grands conflits du siècle précédent nous a montré que les connaissances ne sont pas toujours garantes de vertus humanistes. Cependant, il ne faut pas confondre connaître et savoir : c’est à oublier la phénoménologie de la raison dans l’histoire qu’on perd l’esprit effectif de sa logique de liberté en devenir, et de la politique des vérités et des valeurs qu’elle cherche à universaliser de façon concrète et non pas par des calculs d’entendement abstraits, séparés de la vie concrète des individus et des sociétés.
Vers la dé-démocratisation
Nos sociétés vivent des transformations technologiques et biopolitiques subvertissant les espaces historiques et symboliques traditionnels (Lyotard (7) ou Stiegler (8) ; les progrès de la médecine, de la robotisation, de la biologie moléculaire, et des nanotechnologies cachent mal les finalités de ces techniques inédites. Aussi, on peut se poser la question de la fin de l’Homme ou de l’Humanité : quel type d’humanisme est porté par les démocraties hyper-connectées ? Et n’y a-t-il pas une fin de la démocratie dans une société automatisée totalement rationalisée par des algorithmes et des machines expertes intelligentes ? Il ne s’agit pas de fustiger la technique, les progrès matériels, la société moderne et postmoderne, et de tenir une position technophobe. Mais, bien plutôt, avec patience, d’interroger le sens disruptif de l’humanisme augmenté : qui donne à ce jour aux sociétés branchées et connectées le ton et le canon anthropologique qui lui confèrent son sens et ses fins ? Ce sont les GAFA et les banques financiarisées depuis très longtemps ; et non pas les peuples et les esprits libres. Car ces structures formelles, numérisées, ne sont pas fondamentalement tournées vers un bien ou une amélioration eudémoniste de l’humanité, mais plutôt vers un accroissement de plus values, vers le capitalisme total ou le profit maximum, sans souci du bien social, collectif, ou d’une universalisation de la raison critique.
Le risque est que l’Etat, la loi et l’ordre symbolique ne soient pour le capital source de freins à cette propension à accaparer et une cause de contraintes diverses inhibant son appétit illimité de voracité. D’où la nécessité d’une éducation à l’usage du numérique, éducation et formation à faire, à penser et à dispenser par d’autres formateurs que les producteurs des TIC et les vendeurs de logiciels éducatifs, ou les promoteurs des usages d’applications visant à induire des addictions consuméristes. Il est nécessaire de repenser le calcul, au sens empirique et transcendantal du terme, pour éviter que la pensée qui donne sens à la pratique humaniste de la vie politique sur terre, ne se réduise à une économie abstraite de déductions formelles de calculs de gains et de pertes évalués par des entendements comptables ne tenant pas compte des riches déterminations socio-éthiques composant l’humanité.
Le monde de la numéricie
La philosophie donne au langage une force qui n’est pas celle du code formel ou du langage univoque de la géométrie ; en effet, elle commence par le dialogue et l’échange des raisons. Elle n’est pas pensée mystique, religieuse, ni même essentiellement une théologie ou une sagesse : elle est amour de et pour la sagesse et recherche du sens et des vérités dans et par le langage. En ce sens, la politique de la philosophie est par essence l’échange ou la mise en commun des raisons, le partage du sens et du sensible (Merleau-Ponty (9)). Il s’agit de savoir non pas qui détient la vérité par la force, le droit, la richesse, mais par l’exercice du jugement argumenté. Bien sûr, je peux convaincre par la rhétorique et non pas user de persuasion par l’usage de la raison démonstrative, et ainsi faire illusion en trompant l’autre s’il n’est pas vigilant, attentif, et cohérent. «Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre !» signifie que pour philosopher, il est essentiel d’avoir le sens du logique, la mémoire des définitions reconnues et construites ensemble, et des compétences d’abstraction et de déduction validées par le mathématicien, compétences qui ne font pas le naturel philosophe, sauf à oublier le travail et l’ascèse qui sont à l’origine – et font toujours le travail – de la philosophie.
Descartes, Spinoza, Leibniz, Peirce, par exemple, sont des auteurs qui peuvent être lus comme des apologues du formalisme et de la caractéristique universelle, si on ne prend pas garde justement à ce qu’ils posent conceptuellement comme exigence proprement philosophique et éthique à l’origine de leur grammaire formelle : ils nous disent que la raison n’a de sens qu’à ourdir une cité de citoyens philosophes, d’hommes éclairés sur la nature théologico-politique du meilleur régime politique et que la pensée n’est telle que si elle sollicite la raison critique et le jugement réflexif au principe de chaque acte de la vie de l’esprit, comme au fondement de la vie sociale, civile et politique.
De Hegel à Bataille (10), la raison a subi une dialectique de l’automouvement de sa reconnaissance comme de sa perte, dans des contextes historiques où l’irrationalisme tendait à gagner du terrain par un retour aux «sciences» de la nature dans le romantisme et par le biais du recours à une souveraineté du désir récusant le travail de la raison dans l’histoire. La perte de sens et la destruction de la rationalité par la financiarisation de l’économie : l’économisme comme consumérisme thanatologique. Le risque de l’évaluation totale réside dans cette désinstitutionnalisation du collectif et le repli sur l’individuation permanente et le retrait dépressif hors de ce collectif institutant anthropologiquement notre être et notre devenir au monde et à nous-mêmes. Le danger est alors de vivre hors du symbolique et hors de l’histoire. Il y a donc une urgence à en appeler au courage de savoir et à l’aventure de la liberté de pensée et du penser qui est usage critique de la raison dans tous les domaines, et non pas usage privé et privatif du droit à penser : il ne faut pas confondre le droit de la pensée à savoir ce qu’elle veut penser, et le devoir du savant éclairé de donner au public les fruits de sa réflexion sans la contrainte intérieure de la lâcheté ou la peur de contrevenir à un ordre inique qui maintient l’humanité dans la peur de l’autonomie, de la liberté, et dans l’indignité de son aliénation morale et physique.
Le texte de Kant, mentionné au début de cette étude, portant sur les Lumières est encore d’actualité (Was ist Aufklärung ?) : il y a un devoir de courage dans l’audace d’oser penser en public, contre soi et son époque, afin d’améliorer notre autonomie et notre dignité en considérant notre destination et nos savoirs comme des biens publics et non pas seulement comme des dons personnels ou des propriétés privées. Kant est en effet toujours pertinent quand il en appelle à un usage privé et public de la raison critique.
Faut-il vraiment se réjouir que nous soyons encore à ce jour confronté au problème rencontré et posé par Kant au XVIIIème siècle ?
Faisons donc, de façon résolue, un usage public de la raison tant qu’il en est encore temps et que les nouvelles censures ne nous mettent pas encore sous la tutelle d’une religion de l’obéissance voulant la servitude volontaire de chacun comme principe général d’une citoyenneté aux ordres du marché globalisé pour tous. Il est plus que nécessaire de faire entendre dans l’espace public les raisons philosophiques qui sont fondatrices de nos libertés et qui légitiment la quête avertie de sens dans un monde qui demande qu’on ne le réduise pas un coût ou à un calcul comptable.
Savoir, c’est se ressouvenir que l’humanité est autant, sinon plus, sujet de son savoir, que simple objet, pour elle-même, pour son présent et pour l’invention de son avenir (11).
(1) Nous prenons ici le terme au sens où Kant l’utilise dans son texte Was ist Aufklärung ? (1794), à savoir un usage (en) public de la raison à des fins d’information et de transmission de connaissances.
(2) Pierre Hadot, La philosophie comme éducation des adultes, éd. Vrin, Paris, 2019.
(3) Michel Foucault, Qu’est-ce que la critique ? suivi deLa critique de soi, éd. Vrin, Paris, 2015 ; Les aveux de la chair, éd. Gallimard, 2018.
(4) Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, éd. Minuit, 1969 ; Mille plateaux, éd. Minuit, 1972.
(5) Edward Bernays, Propaganda, éd. Zones, Paris, 2007.
(6) Michel Foucault, L’origine de l’herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth College, 1980, éd. Vrin, Paris, 2013.
(7) Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, éd. Minuit, 1979.
(8) Bernard Stiegler, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? suivi d’un entretien sur le christianisme, éd. Babel, 2018.
(9) Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens(1966), rééd. Gallimard, 1996.
(10) Salim Mokaddem, Bataille dans la philosophie L’héritage impossible, éd. PUL, Montpellier, 1996.
(11) Salim Mokaddem, Eduquer avec Platon, éd. Sos Education, coll. « Réfléchir », Paris, 2016.


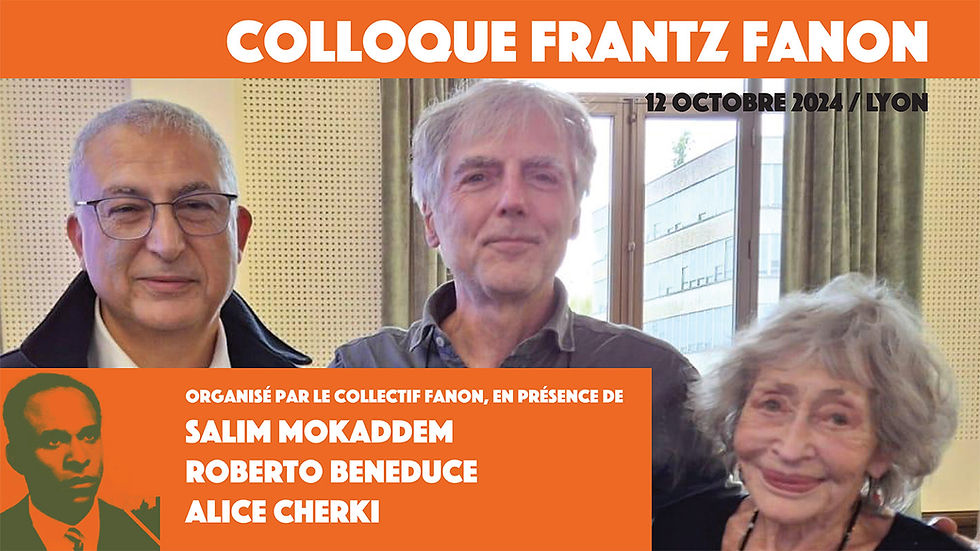


Commentaires